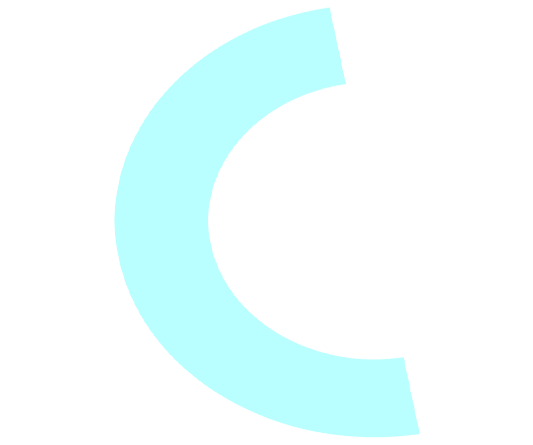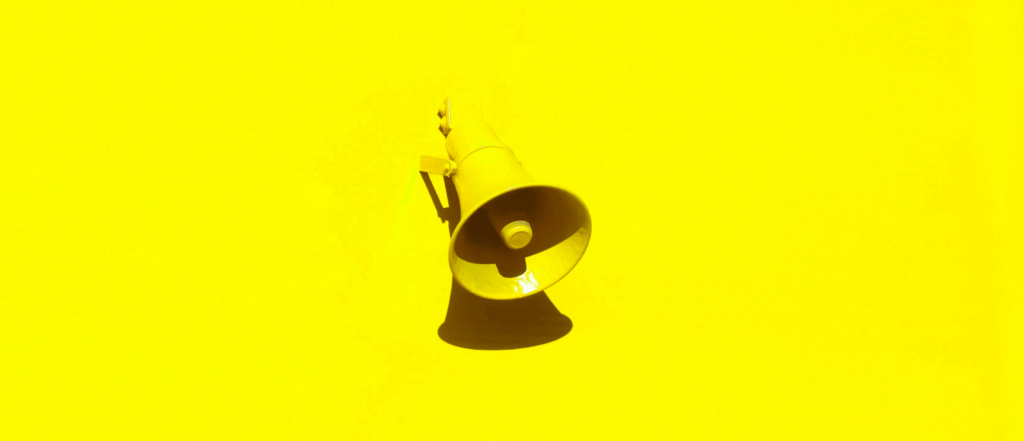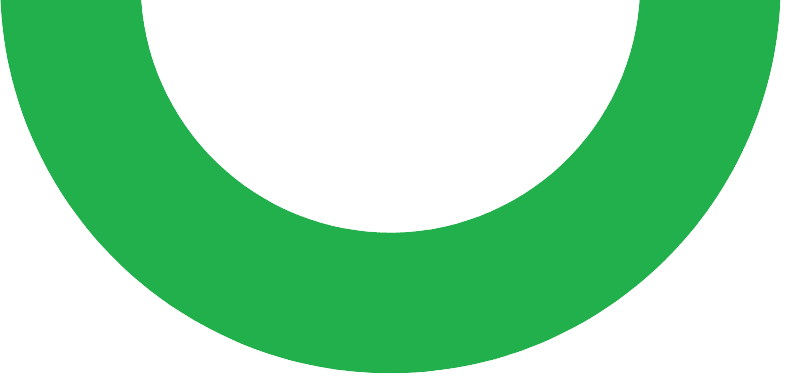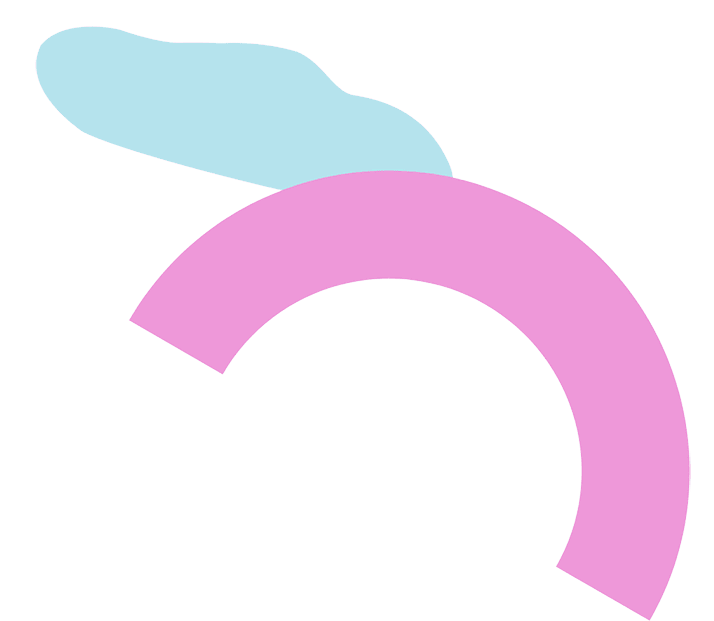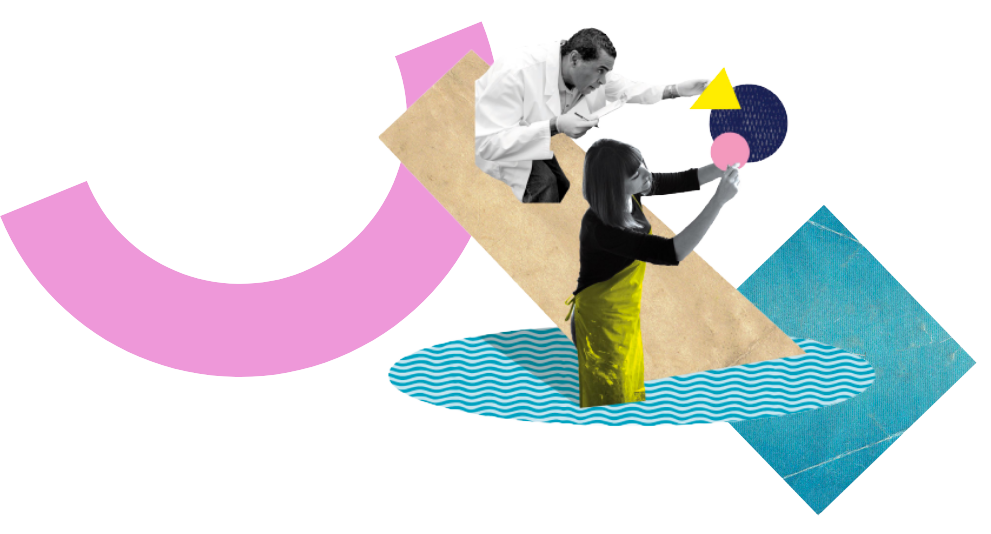La coopération est régulièrement convoquée comme une réponse innovante, nécessaire et citoyenne pour penser le monde de demain. Nous ne dérogeons pas à la règle ici, en alimentant le débat par un point de vue supplémentaire qui s’ajoute à de nombreux autres plaidoyers, depuis la crise sanitaire des deux dernières années notamment. Si l’on a vu, lors de la première vague de COVID-19, l’émergence de multiples initiatives de mobilisation et de coopération d’acteurs socio-économiques pour la fabrication de masques et de protections sanitaires, leur caractère parfois éphémère a pu surprendre qui s’est penché sur le sujet. Certes, cela a pu donner lieu à de nouvelles dynamiques de territoires, la création de pôle d’activités, de réseaux ou de filières ; mais cela a aussi fait ressortir la difficulté à maintenir et nourrir une action collective pérenne, orientée notamment vers la réponse à des enjeux de société. Manque de perspectives collectives ? Manque de ressources ? Modèle économique incertain ? Finalement, pourquoi semble-t-il si difficile de coopérer ?
Si la coopération est « humaine », elle n’est pas une évidence.
Nous ne nous étendrons pas sur les nuances qui distinguent la coopération de la collaboration. Nous prenons ici le parti de la première car « c’est la coopération, et non la collaboration, qui est la source de la prospérité humaine. Car si l’on collabore pour faire, on coopère pour savoir ». Comme le dit notamment Eloi Laurent : la coopération est intrinsèquement humaine – même si elle n’est pas innée. C’est elle qui a permis notre évolution et notre développement, en nous guidant vers un avenir commun et désintéressé, dépassant les intérêts individuels directs. D’autres, bien sûr, ont théorisé la coopération, que ce soit d’un point de vue sociologique et anthropologique, ou même biologique. Certaines approches, comme celle développée par InsTerCoop, en ont fait un principe d’action, considérant qu’il faut pouvoir accompagner la coopération, car elle n’est pas « automatique et doit être étudiée et pratiquée pour être maîtrisée ». En effet, dans un monde dirigé par le collaboratif et l’action rapide, efficiente et innovante de surcroît, la coopération apparaît comme un vœu pieux, voire un principe idéaliste.
Est-ce parce que la coopération est intrinsèque au vivant, qu’il existe si peu de cadres pour la favoriser ? Ou parce que nous ne savons pas comment le faire ?
Tout nous enjoint à coopérer, mais rien (ou si peu) ne s’y prête
Pourquoi idéaliste ? Parce que la coopération dépasse nos intérêts directs et particuliers : elle nous emmène sur une trajectoire de long terme, incertaine et dont les retours sur investissement sont probablement peu tangibles. Or, il s’agit-là de l’exact opposé de ce qui est prôné aujourd’hui, lorsque l’on parle de « projet » : les actions doivent être brèves et générer des résultats de court terme ; elles doivent être concrètes et maîtrisées, organisées et planifiées ; enfin, elles doivent pouvoir rendre compte de leur impact économique et garantir la récolte de fruits juteux… De fait, les cadres de la coopération n’en portent souvent que le nom, tendant plutôt à favoriser la collaboration d’organisations, d’acteurs, de personnes, dans un horizon temporel limité et pour la génération de résultats tangibles. En effet, en-dehors de quelques démarches entrepreneuriales qui visent plutôt la montée en échelle que la coopération à proprement parler (fusions, joint-ventures, co-portage), peu de dispositifs invitent à dépasser l’intérêt individuel pour un intérêt commun. Que l’on pense aux appels à projets dont le destinataire demeure le porteur unique, à la propriété intellectuelle centrée sur l’individu ou l’organisation, à l’accompagnement de l’entrepreneur social avant la dynamique collective, au manque de soutien à l’actions de coordination de collectifs, tout s’oppose aux pré-requis nécessaires à une démarche de coopération. Deux réponses seraient alors possibles face à ce constat : est-ce parce que la coopération, intrinsèque au vivant, ne nécessite pas d’être accompagnée, qu’il existe si peu de cadres pour la favoriser ? Ou bien est-ce parce que nous ne savons pas comment le faire ?
Partager les risques et la valeur, pour transformer les systèmes
Incertaine, intangible et de long terme, la coopération n’apparaît sécurisante pour personne. C’est pourquoi les acteurs, lorsqu’ils s’y engagent, le font probablement en limitant leurs engagements réciproques : l’ambition commune est difficilement identifiable, sinon exprimée par un acteur principal qui prend la lumière ; les responsabilités sont peu partagées, sauf à être très précisément distinguées et réparties ; l’implication dans la dynamique collective ou le projet est rarement équilibrée, quand elle n’est pas simplement portée par un acteur moteur ; la valeur générée se transforme peu en bien commun, mais plutôt en somme de bénéfices individuels… C’est pourtant bien le partage de la vision, des risques, des responsabilités et de la valeur qui fonde et permet la coopération.
Concevoir le bateau, dessiner la carte géographique et identifier les conditions de vie à bord, explorer des horizons plus ou moins lointains pour ouvrir de nouvelles routes.
Co-opérer c’est faire œuvre commune. Il faut parfois oublier le projet pour penser le Projet.
Se projeter ensemble nécessite d’embarquer sur un même bateau, dont l’équipage entier affronterait les houles et partagerait le bonheur d’arriver à bon port. Concevoir le bateau, dessiner la carte géographique et identifier les conditions de vie à bord, c’est ce que nous cherchons à faire avec les acteurs que nous accompagnons. Car c’est bien cela qu’il s’agit d’opérer grâce à la coopération : explorer des horizons plus ou moins lointains pour ouvrir de nouvelles routes. Cela demande du temps pour se laisser surprendre, une implication partagée et une réelle volonté d’action pour chaque partie prenante.
Coopérer, c’est donc accepter des efforts individuels et collectifs, penser les actions et démarches de chacun, tels les musiciens d’un même orchestre, pour parvenir à une finalité commune : un changement de société harmonieux au bénéfice de tous. Là encore, au-delà des pratiques et des méthodes, c’est la direction que l’on se donne et celle que l’on partage, qui permet la coopération : le Projet de Société vers lequel on tend, en commun.
Pour reprendre la formulation de Anne et Patrick Beauvillard, il faut le rappeler : co-opérer c’est faire œuvre commune. Il faut parfois oublier le projet pour penser le Projet.
En savoir plus : La coopération pour la transformation sociale – Coll. Générer l’innovation sociale au service de la Société, volume 2